




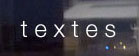



 |
|||||||
 |
 |
 |
 |
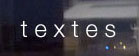 |
 |
 |
 |
| c
a t a l o g u e |
é
c o u t e r < |
i m p r o v i s a t i o n | a
r c h i v e s |
||||
| CD 1 musique pour clavier |
CD 2 musique de chambre |
CD 3 < musique pour ensemble |
CD 4 musique vocale |
CD 5 musique mixte |
CD 6 musique électroacoustique |
CD7 installations |
CD 8 duos |
| |
Antilemme Don Juan est
un sorcier Yaqui, un indien de la province de Sonora — lointain
descendant des Incas. Nous connaissons de son enseignement ce que nous
a transmis un anthropologue américain, Carlos Castaneda, de
l'université de Californie, devenu son disciple. Les livres de
ce dernier sont de difficiles chemins de piste entre une
réalité hallucinée et une sagesse
millénaire. Au cours d'une de ses leçons, Dom Juan
envisage le parcours de l'homme cherchant à acquérir la
connaissance comme une lutte initiatique contre quatre ennemis qu'il
nomme la peur, la clarté, le pouvoir et la vieillesse.
Un lemme est en mathématique une proposition intermédiaire qui constitue une étape, un préalable, dans le cours d'une démonstration plus vaste. Antilemme est un néologisme — une « nouvelle figure du discours ». Ce mot implique une réticence pour l'ordonnance logique de la pensée démonstrative, pour la hiérarchie qu'elle impose parmi les thèses, et plus encore parmi les objets soumis à la pensée. Dimanche 15 avril 1962 : « Lorsqu'un homme commence à apprendre, ses objectifs ne sont jamais clairs. Son dessein est vague, ses intentions sont imparfaites. Il espère tirer un bénéfice qui ne se matérialisera jamais, dans son ignorance des difficultés de l'étude. « Il commence ensuite lentement à apprendre — par petits fragments d'abord, puis par vastes pans. Bientôt ses pensées se heurtent, ce qu'il apprend n'est pas ce qu'il avait imaginé, cela n'a pas l'aspect qu'il attendait, il prend peur. » Chaque nouvelle partition remet en question la possibilité même de savoir composer. Les réminiscences du déjà fait, la tentation de transposer, de se transporter par quelque mécanisme assuré en terrain de connaissance, viennent très vite se mettre à l'épreuve du fait musical nouveau qui lentement, ou brutalement, s'élabore. On n'aborde pas un inconnu sans crainte, sans cet éclat du rire protecteur, masque d'une angoisse immensément insaisissable. « Et que peut-on faire pour surmonter cette peur? « - La réponse est simple; ne pas se sauver. Défier sa peur, et malgré elle, avancer dans le savoir, pas à pas. On peut être profondément effrayé, sans pour autant s'arrêter. Voilà la règle. Puis le moment viendra quand le premier ennemi reculera. L'homme commencera à se sentir sûr de lui. Son dessein sera plus délibéré. L'étude ne sera plus pour lui une tâche insurmontable. A ce moment, on peut prétendre à juste titre avoir vaincu le premier ennemi naturel. (...) Lorsqu'un homme a vaincu la peur, il en est quitte pour le restant de ses jours, car la clarté a remplacé la peur — une clarté de l'esprit qui efface la peur. Mais alors un homme connaît ses désirs, il sait comment les satisfaire. Il peut s'imaginer les nouvelles étapes du savoir, tout se trouve baigné d'une clarté violente. Il sent que plus rien n'est caché. Il vient de rencontrer son deuxième ennemi : la clarté. » Je ne sais plus qui m'a parlé de cette démonstration selon laquelle aucune théorie ne pouvait assurer par ses propres moyens son auto-cohérence. Autrement dit, aucun système ne détient la preuve de sa non-contradiction. L'idée même de cette aporie, mise à nue dans le creuset des symboles mathématiques, m'avait suggéré une passionnante démonstration de l'existence de Dieu. Je n'ignorais certes pas l'artifice, mais je la glissais malicieusement dans la longue liste de celles qui prétendaient s'interposer entre la raison et l'argument ontologique. « Cette clarté d'esprit, si difficile à atteindre, si elle dissipe la peur, aveugle également. Elle pousse l'homme à ne jamais douter de lui-même. Elle lui donne l'assurance de pouvoir faire tout ce qu'il veut, car il semble voir clairement au fond des choses. Il est courageux parce qu'il est clair, rien ne l'arrête pour la même raison. Or tout cela n'est qu'une erreur. C'est comme une chose incomplète. Si l'on cède à cette puissance apparente, on est devenu le jouet du deuxième ennemi, et l'apprentissage s'en trouvera tout faussé. La précipitation remplacera la patience, ou le contraire. Et la conséquence de ces erreurs, il lui deviendra impossible de rien apprendre. (...) Il n'en aurait d'ailleurs aucune envie. » J'ai toujours dit que je composais la musique que j'aurais aimé entendre. Il y va, on l'aura compris, d'un certain rapport à l'inouï. J'ai toujours dit également que pour moi la musique contemporaine restait encore à écrire. Je ne parle pourtant pas qu'une insatisfaction chronique et présomptueuse, d'un étrange état de « manque ». Peut-être un peu de cette éternelle renaissance de l'homme à lui-même qui faisait dire à Montaigne : « je ne peins pas l'être, je peins le passage ». Aucun art plus que la musique n'est plongé à ce point dans le transitoire, l'éphémère, le fugitif. Tout, dans la musique, échappe quelque part à notre connaissance. Or dans notre civilisation, la musique s'écrit, elle s'écrit jusqu'à une complexité impraticable, jusqu'au pari d'une simplicité inhabitable. Dans l'écriture, toutes les projections sont possibles, toutes les dimensions du sonore prennent l'évidence du symbole. « Le moment viendra où l'on comprendra que cette clarté n'était qu'un point devant le regard. C'est ainsi que le deuxième ennemi aura été surmonté, et que l'on parviendra à l'endroit où plus rien de mal ne peut arriver. Il ne s'agira plus d'une erreur, ni d'un simple point devant les yeux. ce sera la vraie puissance. L'homme saura alors que la puissance qu'il poursuit depuis si longtemps lui appartient enfin. Il en fera ce qu'il voudra. Il a son allié à ses ordres. Ses désirs font loi. Il voit tout ce qui l'entoure. C'est ici qu'il rencontre son troisième ennemi : le pouvoir. C'est le plus puissant de tous ses ennemis. Le plus facile, naturellement, c'est d'y céder. après tout, l'homme est vraiment invincible. Il commande. Il commence par prendre des risques calculés, il finit par dicter les règles, puisqu'il est le maître. A ce stade, on remarque à peine le troisième ennemi qui s'approche. Et soudain, sans qu'on s'en aperçoive, la bataille est perdue. L'ennemi a fait de lui un homme capricieux et cruel. » Antilemme. Ce terme impossible ressemble à un miroir qui renvoie à l'esprit la violence de sa science. pourtant, à l'écouter, ce sont d'autres consonances qui viennent. Bien sûr, ces ruptures et ces métaphores, ce grand projet d'une carrière pour la pensée comme pour le corps, cette révolte mythique vouée à un échec retentissant. On ne se révolte pas impunément contre la logique du monde. Les choses parlent — les instruments s'imposent... L'implacable certitude poursuit son mouvement. L'harmonie universelle a lancé ses sphères pour une trajectoire incontournable. Et au milieu de ce désert, de ce désastre parfait, l'homme naît d'un chant funèbre, innocent et dérisoire comme une cantilène. « Il doit se dominer à chaque instant, manier avec précaution et fidélité tout ce qu'il a appris. S'il voit que la clarté et la puissance, sans la raison, sont encore pires que l'erreur, alors il atteindra le point où tout est sous son contrôle. Il saura alors qu'il a vaincu son troisième ennemi. L'homme sera alors au terme de ce voyage à travers le savoir, quand presque sans prévenir surgira le dernier de ses ennemis, la vieillesse. C'est le plus cruel de tous, le seul qu'il ne pourra pas vaincre complètement, mais seulement tenir en respect. On n'éprouve plus alors de peur, la clarté de l'esprit ne provoque plus d'impatience — la puissance est maîtrisée, mais on est pris du désir opiniâtre de se reposer. » Il est toujours difficile de se remémorer comment naît une pièce, surtout quand le temps qui servit à l'écrire est morcelé par les aléas de l'existence. A chaque retour à la table de travail, il faut renouer les linéaments interrompus, retrouver les volontés oubliées... Qu'est ce qui subsiste de l'essentiel au travers de cette trame implacable de la subsistance? Les temps se superposent — l'auditeur y ajoute le sien — les moments entrechoquent leur conscience. Il n'y a pourtant qu'une direction, inéluctable. « On n'éprouve plus alors de peur, la clarté de l'esprit ne provoque plus d'impatience — la puissance est maîtrisée, mais on est pris du désir opiniâtre de se reposer. Si l'on s'y abandonne totalement, si l'on se couche et qu'on oublie, la fatigue venant comme un apaisement, la dernière bataille sera perdue, son ennemi l'abattra comme une créature âgée et sans défense. Son désir de retraite obscurcira clarté, puissance et savoir. « Si l'homme cependant surmonte sa fatigue et accomplit son destin, on pourra vraiment l'appeler homme de savoir, même s'il n'a pu qu'un bref moment repousser son dernier ennemi invincible. Ce moment de clarté, de puissance et de savoir aura suffi. » |
|
|
Dilemme pour soprano et ensemble (1995) (fl, hb, cl, vl, vla, vc, pn) Ensemble Aïsthésis,
direction Michel Pozmanter Seule avant l'ombre
>
en savoir plusSon - otage (du temps) - ma vie effacée de la mémoire du monde hantera l'imaginaire du néant long instant - vide hurlant de douleur et de joie sans fin brusquement le signe secret de la nuit masque le silence de l'air l'ombre vous parle - doucement l'arche violente construite (en dépit de tous les présages funestes) dans ce lieu somptueux - superbe - sera déchiquetée par le chien noir des étoiles Sur cet immense tapis rouge et bleu cerné d'or Je vois (est-ce un songe?) l'oiseau lumière pris dans cette spirale - l'oiseau blanc - autour de lui des volutes de flammes - où que ma tête se tourne - le feu - l'univers change - je vois l'éclatante lueur de la mort, je vois des désastres sans nombre. (l'eau et le feu - la lumière et l'ombre - terre et ciel - guerre et paix - son contre silence - le haut et le bas - vie mort - temps contre temps - corps contre corps - l'autre et le même) l'autre est le même amour Partir ou rester là je sens en moi comme une force inconnue et immense Oublier la peur sourde (et ses images séduisantes) je sens l'aorte infime se dilater Vers quel rêve? je sens venir l'heure La fin éclatante Je suis seule entourée d'or et de feu. Nous avions ouvert les portes une à une jusqu'à ne plus rien savoir du jour ou de la nuit Nous avions gravi les marches d'escaliers sans fin Des échelles de toutes tailles partaient dans toutes les directions s'appuyant désespérément les unes sur les autres Les racines des arbres pendaient dans le vide, à la recherche de l'humidité de la terre Des branches, échappées par l'embrasure des portes, s'élançaient vers la lumière Et cette même quête, double, continuera-t-elle encore longtemps à disloquer mon âme? Je ne sais pas à qui je pense en fermant les yeux Seule à seule avec l'aveu aveugle Aveux arraché à l'éclat effacé L'éclat volé au ciel Monde d'ombre son de son émoi étoilé Silence identique en moi aux voix qu'on doit aux oiseaux Tant d'angoisse et tant d'euphorie Ce dilemme me tue et me fait vivre |
 |
|
|
Traversée du vent et de la lumière pour ensemble (2007) Dédiée à Vincent Planès Ensemble du Festival de Musique de
Chambre du Larzac
…
traversée du vent et de la lumière
L’ombre du désir de capter la force des astres éparpillée dans son étouffement Le tronc noué par quelque peur remué depuis ses extrémités innombrables Choisissant dans l’expression de la périphérie ce qui sera le centre de sa future expansion … pour frayer avec une symétrique aisance des chemins bifurqués contredisant (de l’eau) la cinglante gravité Jusqu’à briser la pierre ou renverser la tombe Et la surface — toujours extrapolée — rendant chaque automne mille images enflammées de soi […] D’un être foisonnant d’interstices la présence traversée du vent et de la lumière |
  |
|
|
Un jardin de Theleme pour chef d'orchestre et ensemble d'improvisateurs (2004) Laboratorio NovaMusica
dirigé par Giovanni Mancuso Cette partition ressemble à l’utopie d’une écriture musicale qui ne maîtriserait pas le résultat sonore avec la précision de la note, mais proposerait un tracé des éléments musicaux dans le temps, conforme aux repères les plus manifestes pour la perception. Toute musique se construit avec pour référent inconscient l’écoute d’un auditeur. La confection millénaire d’un paysages ne répond elle pas elle aussi, secrètement, au regard de l’homme ? Cette partition est en somme une partition de gestes. Sonores, bien-sur, mais aussi physiques. Ces gestes sont ceux d’un chef d’orchestre. Mais ce sont aussi peut-être les gestes intérieurs évoqués par la perception auditive. Une telle proposition pourra être, d’ailleurs, interprétée comme une pure chorégraphie. Dans ce cas, le danseur-chef-d’orchestre devra l’exécuter de mémoire. La pièce ne pourra être exécutée en public sans un minimum de deux répétitions où tous les musiciens seront présents. Cela est nécessaire pour qu’ils puissent se familiariser avec le langage gestuel spécifique qui est utilisé et qu’ils puissent réagir sans inhibition. Cette exigence reste valable pour une version où le chef voudrait diriger le public lui-même. La partition a toutefois été écrite pour quatre groupes et un total de dix musiciens improvisateurs. On pourra l’exécuter sans difficulté avec d’autres instrumentistes que ceux indiqués. La formation minimale requise est la suivante : flûte, saxophone (ou clarinette), trompette (ou trombone), percussion et contrebasse. D’autres répartitions des différents pupitres sont possibles, mais elles doivent s’attacher à conserver l’équilibre des groupes. L’instrumentiste d’un groupe en sous-effectif prendra en charge les indications des pupitres non pourvus de son groupe. Dans le cas où les instrumentistes seraient plus nombreux que le nombre de pupitres par groupe, on veillera à l’homogénéité sonore des pupitres. On peut envisager une réalisation chorale. Dans ce cas, la partition sera lue avec les groupes suivants : sopranos, altos, ténors et basses. La disposition des musiciens devra faciliter leur désignation par le chef. On donne ci-après le schéma de la disposition scénique optimale, dans le cas d’un orchestre instrumental, et dans le cas d’un chœur. |